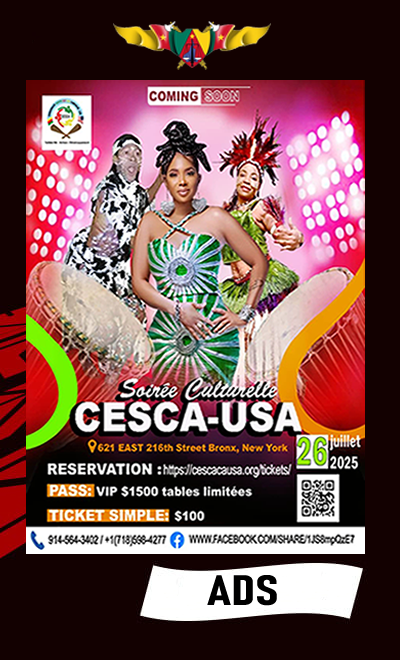[ad_1]
►►Les Etats-Unis ont officiellement annoncé mardi qu’ils se retiraient à nouveau de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), et ce avec effet le 31 décembre 2026. Il s’agit du troisième désengagement américain en plus de 40 ans, révélateur d’une politique étrangère marquée par des revirements successifs vis-à-vis des institutions multilatérales.
PARIS-Les Etats-Unis ont officiellement annoncé mardi qu’ils se retiraient à nouveau de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), et ce avec effet le 31 décembre 2026. Il s’agit du troisième désengagement américain en plus de 40 ans, révélateur d’une politique étrangère marquée par des revirements successifs vis-à-vis des institutions multilatérales.
Tammy Bruce, porte-parole du Département d’Etat américain, a justifié cette décision en affirmant que « la poursuite de la participation des Etats-Unis à l’UNESCO n’est pas dans l’intérêt national ». Elle a reproché à l’organisation la promotion de « causes sociales et culturelles clivantes », l’adoption d’une idéologie jugée « mondialisée et idéologique », incompatible avec la doctrine « America First », ainsi qu’un « parti pris contre Israël », notamment depuis l’admission de la Palestine comme Etat membre en 2011.
Cette décision relance le débat récurrent sur l’engagement américain dans les instances multilatérales. Plusieurs experts et élus démocrates ont mis en garde contre l’affaiblissement de la voix des Etats-Unis dans la gouvernance mondiale.
Le représentant démocrate Gregory Meeks, membre de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, a estimé qu’un retrait unilatéral « affaiblit le leadership mondial américain et introduit les corrosives guerres culturelles MAGA (Make America Great Again, NDLR) dans la politique étrangère ». Il a jugé cette décision « irréfléchie, contre-productive et nuisible aux intérêts américains pour des années à venir ».
La politologue franco-américaine Amy Greene, citée par l’hebdomadaire français Le Point, voit dans cette décision une nouvelle manifestation de l’influence de la politique intérieure américaine sur les relations internationales : « cela témoigne du fait que même les organisations multilatérales internationales ne sont jamais à l’abri de la politique domestique des Etats-Unis et, plus particulièrement, d’une forme de prolongation de cette politique domestique sur la scène internationale ».
Ce retrait des Etats-Unis ne surprend pas les responsables de l’UNESCO, qui l’avaient anticipé après la demande de révision formulée plus tôt dans l’année. Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, a exprimé son « profond regret », tout en indiquant que son organisation s’était préparée à cette éventualité qui est « contraire aux principes fondamentaux du multilatéralisme ».
Elle a mis en avant les réformes lancées depuis 2018, visant à diversifier les financements et à réduire la dépendance aux Etats-Unis, dont les contributions sont désormais limitées à 8% du budget. De plus, aucun licenciement n’est prévu à ce stade et ses programmes phares tels que le patrimoine mondial, l’éducation, l’IA et la lutte contre les discours de haine devraient se poursuivre sans interruption.
La France a rapidement réagi par la voix de son ministère des Affaires étrangères, saluant les initiatives de l’UNESCO dans les domaines de l’éducation, de l’intelligence artificielle (IA) responsable, de la lutte contre l’antisémitisme et de la protection du patrimoine. Le président français Emmanuel Macron a quant à lui réaffirmé le « soutien indéfectible » de la France à l’UNESCO, assurant que « le retrait des Etats-Unis ne fera pas faiblir (son) engagement ».
Les Etats-Unis, membres fondateurs de l’UNESCO en 1945, avaient déjà quitté l’organisation en 1984 sous la présidence Reagan, dénonçant une gestion inefficace et un biais anti-occidental. Ils y étaient revenus en 2003 sous George W. Bush, puis s’en étaient de nouveau retirés en 2017 sous Donald Trump. Le retrait actuel intervient après que l’administration Biden avait réintégré le pays en juin 2023, traduisant un revirement diplomatique marqué en à peine deux ans et illustrant la volatilité de la politique étrangère américaine.
[ad_2]
Source link